 Arabic
Arabic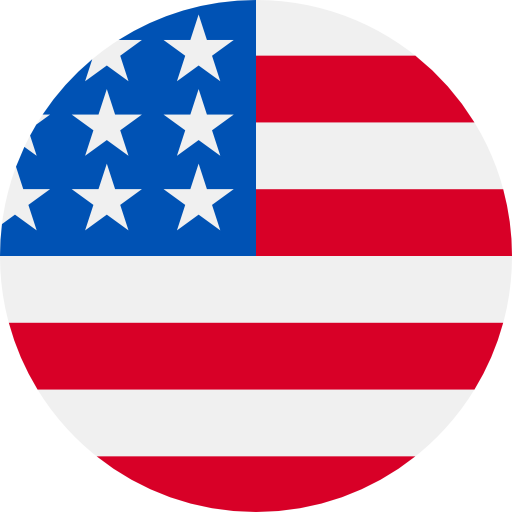 English
English Deutsch
Deutsch French
French Italian
Italian Español
Español Català
Català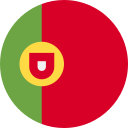 Português
Português Nederlands
Nederlands 日本語 Japanese
日本語 Japanese Polski
Polski Russian
Russian Svenska
Svenska Ukrainian
Ukrainian Türkçe
Türkçe Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia Bahasa Melayu
Bahasa Melayu ไทย Thailand
ไทย Thailand Filipino
Filipino हिन्दी Hindi
हिन्दी Hindi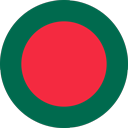 বাংলা Bengal
বাংলা Bengal اردو Urdu
اردو Urdu Tiếng Việt
Tiếng Việt 한국어 Korean
한국어 Korean 粵語 Cantonese
粵語 Cantonese 繁體字 Taiwan
繁體字 Taiwan 中文 Chinese
中文 Chinese 閩南語 Bân-lâm-gú
閩南語 Bân-lâm-gú Bulgarian
Bulgarian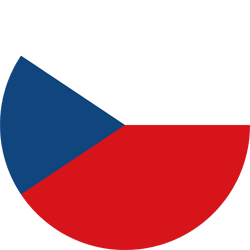 Čeština
Čeština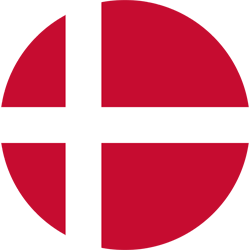 Dansk
Dansk Esperanto
Esperanto Euskara
Euskara فارسی Persian
فارسی Persian עברית Hebrew
עברית Hebrew Magyar
Magyar Norsk Bokmål
Norsk Bokmål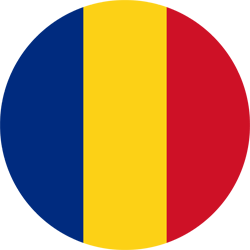 Română
Română Srpski
Srpski Srpskohrvatski
Srpskohrvatski Suomi
Suomi Asturianu
Asturianu Bosanski
Bosanski Eesti
Eesti Ελληνικά
Ελληνικά Simple English
Simple English Galego
Galego Hrvatski
Hrvatski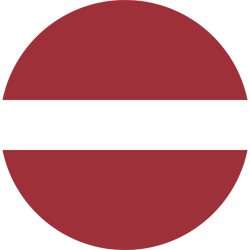 Latviešu
Latviešu Lietuvių
Lietuvių മലയാളം
മലയാളം Македонски
Македонски Norsk nynorsk
Norsk nynorsk Slovenčina
Slovenčina Slovenščina
Slovenščina Tamil
Tamil
Insoumission à l’école obligatoire/6
Vers douze, treize ans, il n’est pas rare qu’en lisant sur une plage de vacances les Provinciales ou Atala on se considère avec le grand respect dû aux êtres qui « pensent ». On est intellectuel et fier de l’être. On ne se sent pas n’importe qui si l’on goûte Pascal et nourrit ses soirées de Chateaubriand (Günter Grass ou Marguerite Duras si l’on est « moderne » ). Vertigineuse ivresse de se montrer supérieur aux petits frères et sœurs, voire à papa et à maman, au livreur, à la boulangère. Tu aurais l’âge de ces émois ; sans doute es-tu bien privée de si délicates jouissances.
Ce sentiment de supériorité du jeune adolescent s’émerveillant de lui et de son regard sur le monde, c’est celui, identique, qu’on retrouve chez la plupart des enseignants. Ce n’est pas qu’ils soient forcément plus niais que la plupart des mortels, mais on les a soigneusement entretenus dans cette idée assez ridicule qu’ils sont utiles à l’humanité parce que dépositaires et dispensateurs du savoir (quelques-uns n’hésiteraient pas même à parler de culture !).
Ils font un métier ingrat, je n’en doute pas. D’où la nécessité de quelques compensations : aux clercs on doit le respect. Eux-mêmes se tiennent en immense estime : le « corps professoral » est atteint d’un narcissisme adolescent : il s’aime, il se plaint, il se critique, il se pardonne.
Il y a quelques enseignants qui ne sont pas visés dans ce chapitre. Soit qu’une passion incompréhensible et folle comme toute passion les anime ; soit qu’au contraire ils parviennent à assurer leur boulot sans trop y penser, comme on arrive quelquefois à faire la vaisselle, réservant toutes leurs énergies à ce qui les intéresse par ailleurs ; soit encore qu’ils vivent malades, déprimés et ne rêvent que de changer de métier.
Que l’on ait, depuis toujours, voulu protéger l’enfant contre les maîtres d’école ne peut surprendre qu’eux[1].
« Un maître d’école ou un professeur ne peut élever des individus ; il n’élève que des espèces[2]. » C’est bien pourquoi il peut compter sur la complicité de son auditoire. Les élèves ont eu le temps de s’accepter « élèves ». Plus tard, certains seront instits ou profs, n’ayant jamais trouvé le temps ni l’occasion dans leur petite vie de désapprendre les fadaises ingurgitées. Ils gobent tout. Les rares qui ont l’esprit critique se font insulter, ou se taisent, ou se pendent. À priori, les écoliers ne valent pas mieux que leurs enseignants. Je note cependant qu’ils risquent bien plus, en se rebellant, que les profs. Le chantage à l’affection est ici cruel, terrifiant. Bien souvent, se dresser contre l’école signifie se dresser contre TOUT son entourage, tous ceux qu’on aime ; on est menacé, dans certains milieux, d’un « placement » par l’intermédiaire de la D.D.A.S.S., dans d’autres de l’internat dans un collège où l’on sait mater les durs.
Dès les premières heures d’école, les sanctions ou récompenses ont accaparé toute l’attention émotionnelle des enfants. Si le maître ou la maîtresse « fait peur », une classe enfantine peut soudain découvrir qu’elle forme un groupe, une force. La guerre commence. De toute façon, elle viendra.
Les enseignants supportent forcément mal cette tension. Les élèves travaillent incontestablement plus que les professeurs, en moyenne dix heures par jour s’ils veulent tout faire ; dix heures consistant à apprendre (peu d’adultes accepteraient un tel effort plus de deux heures). Ils sont énervés et « insupportables ». Mais davantage les uns envers les autres qu’envers le professeur : chaque élève doit subir sa classe un nombre d’heures bien plus impressionnant que l’enseignant. En rentrant à la maison, il a plus de travail que lui, toutes copies à corriger et travail de préparation de cours confondus. L’énervement dont se plaignent élèves et professeurs n’est pas une plaisanterie, les uns et les autres alternent « remontants » et « tranquillisants ».
Comment peut-on être professeur ?
Rester toute sa vie dans les bâtiments scolaires doit certainement empêcher l’irrigation d’un cerveau au départ normalement constitué.
Curieusement, les enseignants, dans leur ensemble, souffrent assez fréquemment d’un complexe de supériorité vis-à-vis de leurs collègues, de la bêtise desquels ils se méfient. Il est connu qu’en classe d’examen les profs de français, de philo ou d’histoire recommandent à leurs élèves les plus « doués » de ne pas être trop subtils le jour de l’épreuve (c’est encore plus vrai quant aux thèses, mémoires et concours dans l’enseignement supérieur).
Leur suffisance les rend volontiers pointilleux à l’égard de leur image de marque. L’expression « petit-bourgeois » semble avoir été uniquement inventée pour eux. Récemment, on me rapportait cette anecdote tellement significative. L’administration pénitentiaire et l’Éducation nationale avaient conclu un accord pour tenter une expérience de formation professionnelle de jeunes détenus en semi-liberté dans un établissement scolaire. Des « précautions » ont bien entendu été prises pour éviter que ne se rencontrent les loups et les agneaux-élèves du lycée. Mais, au réfectoire où mangeaient les jeunes détenus stagiaires, les professeurs étaient censés prendre aussi leur repas. D’eux-mêmes, les enseignants ont pris l’aimable initiative de dresser des paravents. Ces parvenus sont consternants de médiocrité.
Ils ont les combats qu’ils méritent. La Fédération de l’Éducation nationale, la très républicaine, est une confrérie corporatiste, profondément bête, qui se flatte d’être ouverte à toutes les tendances de la connerie. Elle apparaît « traversée de courants contradictoires », signe qu’elle reste « fondamentalement attachée aux valeurs démocratiques ». Elle est bien entendu de gauche et ultra-conservatrice, emploie ses millions de syndiqués à défendre leur statut de fonctionnaires et de laïcité. Programme passionnant.
Je ne serais amère que si je t’avais abandonnée entre leurs sales pattes roses. Je parle ici d’eux avec un absolu détachement. Mais j’entends trop souvent dire qu’ils ont des excuses et qu’en « tête à tête » ils ne sont plus aussi idiots. Cette générosité débonnaire qu’on leur témoigne, et que l’on a rarement envers la police par exemple, m’apparaît trop empressée pour être honnête : on a toujours intérêt à se faire bien voir des professeurs. Mais moi, ça va, j’ai déjà donné. Et il y a peu de chances pour qu’ils aient la possibilité de te le faire payer un jour. Sévère, mais juste, je répète que neuf enseignants sur dix sont des minables.
Cela s’explique par leur recrutement (tu es bon en histoire ? tu seras prof d’histoire et de géographie par-dessus le marché ; tu es bon en gym ? etc. — ne parlons même pas des écoles normales d’instituteurs qui sont bien souvent la dernière chance de ne pas finir vendeur de grand magasin ou fille de salle), par le fait épouvantable qu’ils restent à l’école toute leur vie et que ça rendrait névrosé n’importe qui, enfin parce qu’ils sont, pour la plupart, fonctionnaires et que leur fonction est d’entretenir un mensonge dégueulasse sur la « transmission » complètement mystificatrice du savoir à de prétendus « futurs adultes ».
On leur reproche principalement de manquer de culture et de ne pas comprendre les enfants. Mais comment en serait-il autrement ? Leur culture n’est que scolaire, c’est-à-dire pratiquement nulle. On peut encore s’estimer heureux si la matière qu’un professeur enseigne l’intéresse assez pour lui avoir donné quelque curiosité en ce domaine. On ne va quand même pas, en plus, lui demander d’être un « honnête homme » et de se repérer dans la civilisation au sein de laquelle il vit. À quoi bon lire un auteur anglais quand on enseigne le russe ? Pourquoi aller voir telle exposition quand ce n’est pas au programme ? D’abord, ça ne compte pas pour les points d’avancement et l’inspecteur ne le demande pas.
Je n’ai pour ma part rien d’une femme cultivée ; je t’ai toujours dit que je ne savais rien et que je ne pouvais rien t’apprendre ; l’absence de culture n’est pas une tare ; ce qui est excessivement pénible, c’est d’entendre des gens incultes se dire les « gardiens de la culture ». Souvent, tu le sais, Marie, des amis qui ont des enfants, cherchant une oreille compatissante, m’apportent des corrections de professeurs ou encore des « résumés ». J’ai renoncé à faire un bêtisier. Bien d’autres que moi se sont livrés à ce triste jeu. Et qu’on ne s’avise pas de dire que la sélection devrait être plus rigoureuse. Il est notoire que, dans notre système, plus les études sont « difficiles » et plus les rescapés sont étroits d’esprit et bornés.
Quant au reproche de ne pas savoir établir de rapport avec un enfant, il va de soi que ne voir en quelqu’un qu’un « futur quelqu’un » ne peut qu’engendrer un horrible malaise : ajoutons à cela le rôle de « surveillance » sur lequel je ne reviens pas et qui ne peut que produire le mépris des deux côtés.
On se scandalise un peu trop vite de ce qu’une maîtresse morde un enfant de huit ans. Personnellement, je suis plutôt rassurée que puissent encore advenir des choses pareilles. Ce n’est pas cela qui me donne la chair de poule. Mais par exemple que tel maître de C.E.1 dise à Véronique que son fils « n’arrive pas à comprendre qu’à l’école il faut être sage et qu’à plus forte raison il ne comprendra jamais rien d’autre », que le même, à l’issue de l’entretien, dise devant moi sur un ton plaintif : « Je suis ici pour gagner ma croûte, pas par pédophilie », alors que Véronique lui demandait si son métier d’instituteur lui procurait quelque plaisir.
Assurément, il y a peu de gens qui travailleraient dans leur métier s’ils n’y étaient pas obligés, mais as-tu déjà entendu des charcutiers, des architectes, des facteurs, des mineurs, des pharmaciens se lamenter en un si beau chorus sur les servitudes de leur profession ? Je trouve aussi que vivre avec des êtres condamnés à rester toute leur jeunesse enfermés est un enfer, mais que les maîtres cessent une fois pour toute de parler de leur « dévouement bafoué »…
Ils « se donnent un mal fou » pour séduire des jeunes qui ne veulent rien savoir. La « pédagogie de l’éveil » consiste, dès qu’un enfant s’intéresse à quelque chose, à faire de sa découverte un horrible « objet d’apprentissage scolaire », à détourner son action au profit d’une activité. Les porcs…
Comment pourraient-ils d’ailleurs démythifier ces techniques, eux qui sont les plus soumis des hommes aux préjugés du siècle ! Car c’est à eux, les professionnels (par opposition aux parents qui ne resteront toujours que des amateurs), qu’est confié le soin sacré de transmettre les idées préconçues, tout ce qu’il faut savoir pour perpétuer la vie en société telle que nous la connaissons. Très peu pour nous. Pourquoi vivre dans le malheur sous prétexte qu’on nous a toujours appris qu’il fallait « en passer par là » ? « En passer par là », c’est-à-dire par les rapports entre les gens, au monde, à la connaissance, par tout ce qui est faisandé.
Loin de moi l’idée militante d’assurer que les maîtres qui font la cuisine ont tort. Ce n’est, vraiment, qu’une question de goût. Mais il m’est difficile, sous prétexte qu’on a fui cette valetaille qui porte avec tant de fatuité la livrée de sa société, d’ignorer par discrétion ses dégâts magistraux.
On ne peut manquer en tout cas de rappeler qu’ils sont directement responsables du massacre des intelligences. Je ne crois pas que l’abrutissement général soit congénital. « C’est la faute des médias. » Bien sûr, et les profs en sont les employés au même titre que les journalistes. Ils font d’ailleurs rigoureusement le même boulot : ils forment en informant, ils transmettent ce qu’on doit retenir. Pareillement un chanteur serine des paroles et musiques au goût du jour. Mais ce qui est plus grave, chez les enseignants, c’est qu’ils se montrent d’une inconscience qu’on n’a pas souvent dans le show-biz. Les professionnels de l’abêtissement qui se produisent à la télévision n’ont jamais la prétention de savoir qui, dans leur public, est à garder ou à jeter. À priori, ils ont l’honnêteté de s’en foutre. Alors que les maîtres sont investis de la sale besogne (jamais refusée) de sélectionner, de trier dignes et indignes.
Tu sais qui est Pygmalion ? Tu regarderas dans le dictionnaire. Tu comprendras mieux ainsi le titre de Pygmalion à l’école[3]. Il s’agit d’une expérience cruelle et marrante. (Tu me connais assez, petite fille, pour savoir que je ne te fais part des « expériences psychosociologiques » qu’en tant qu’elles sont des paraboles. Je n’ai aucune raison de croire sur parole les savants, surtout en « sciences humaines ».)
À l’origine, une première étude célèbre de Rosenthal sur les chercheurs face à l’expérimentation[4]. On confie à un groupe des rats qu’on prétend sélectionnés en « stupides » et « intelligents » (en réalité, les rats sont pris au hasard). On fait faire aux rats différents exercices. On note leurs progrès. Ensuite, un autre groupe prend en charge les mêmes rats ; les bestioles sont censées montrer comme précédemment leurs aptitudes, mais, cette fois, on a échangé les petites pancartes. Que crois-tu qu’il arrive ? Les chercheurs du premier groupe trouvent effectivement que les rats « intelligents » réussissent bien mieux que les rats « stupides ». Et… le groupe suivant aussi, avec les rats « inversés ». Les rats étiquetés « intelligents » obtiennent toujours le meilleur score.
Des sociologues américains ont repris — c’était tentant — la même expérience, cette fois en donnant à des maîtres d’école des indications totalement arbitraires sur le niveau intellectuel des élèves. Les résultats scolaires ont confirmé non pas la réalité mais les fausses informations données par les chercheurs. Les supposés bons élèves sont effectivement devenus les meilleurs. On a voulu critiquer ces résultats. L’argument des contestataires est des plus désopilants : les maîtres en question auraient été victimes de leur souci de justifier le verdict des soi-disant psychologues qui les avaient induits en erreur… Eh oui, mais c’est très exactement là que leur conformisme dépasse les bornes.
Les sous-populations scolaires sont hiérarchisées (lycées, C.E.T., facultés, grandes écoles) et, à l’intérieur même des établissements, la ségrégation se fait encore selon les sections, les langues choisies. Chaque professeur se trouve face à une bonne, moyenne ou mauvaise classe et je ne connais pas d’exemple qu’une classe « faible » fût devenue « forte ». Évidemment, me répond-on, cela ne pourrait arriver qu’à des individus et non à une classe entière. Je serais d’accord. Mais ce que j’aimerais alors comprendre, c’est pourquoi et comment ce sont des classes entières qu’on manœuvre dans leur ensemble en tant que « bonnes » ou « mauvaises », sans que jamais le nombre d’individus fasse obstacle au maintien d’un niveau donné.
Existe-t-il beaucoup d’enseignants qui entrent pour la première fois dans une classe en se disant : « Tous ceux qui sont ici peuvent être intelligents et heureux d’apprendre. Il suffirait qu’ils soient libres de venir et que l’enseignement me passionne » ? Non bien sûr, un professeur sait, en entrant dans une classe, que les jeux sont faits et qu’il n’est chargé que de maintenir les choses en leur état.
Aucune contradiction d’ailleurs entre ce rôle sans gloire et leur sens de l’autorité. Tu connais la pensée de ton grand-père sur les officiers : ils choisissent non de commander mais d’obéir. C’est vrai de tous les enseignants en général. On a trop souvent tendance à chercher dans leurs manies tyranniques la revanche sur leur enfance humiliée. Les professeurs joueraient les despotes pour compenser un sentiment d’infériorité. L’explication est bêtasse. Peu choisissent l’enseignement pour écraser les petits. Mais beaucoup, par contre, s’engagent dans l’Éducation nationale parce que c’est pépère, qu’on n’y a pratiquement aucune responsabilité.
Que leur besoin de sécurité dégénère en besoin d’ordre et de conformisme est moins lié à une psychologie qu’on aurait du mal à leur voir commune qu’à la conséquence logique d’un système éducatif fondé sur le respect de tout ce qui est établi. Ils ont à « faire passer » cela justement. Quand ils exigent de parler seuls, dans le recueillement, quand ils châtient les rebelles, ce n’est pas qu’ils soient autocrates dans l’âme mais de zélés serviteurs de l’institution qui ne peut fonctionner – c’est sa raison d’être – que dans l’obéissance aux règles.
Serviles et despotiques, ils donnent la pleine mesure de leur petitesse face à l’inspecteur. L’inspecteur ! Tous les enseignants vivent dans la hantise de ses visites et de ses rapports. Il faut les voir alors quémander la complicité des élèves dans la comédie qu’ils donnent. Surtout, ne jamais prendre d’initiative que le grand manitou puisse mal juger ou sanctionner. Mieux vaut respecter les règles du jeu. Être « original » est a priori suspect. Il convient de « faire comme les autres ».
Quand tu étais petite, tes amies se faisaient toujours une grande joie de jouer avec toi « à la maîtresse » ; pauvre écolière victime, tu devais subir des admonestations menaçantes, des hurlements hystériques. Alors que je me gardais de te parler de l’école, tu recevais de tes camarades une caricature qui était bien issue de leur expérience. Les « grands » étaient persuadés que je t’« influençais » alors que seules tes compagnes de jeu te donnaient une « représentation » de ce qu’était à leurs yeux l’école : le lieu où « la maîtresse crie » ; je suis prête à parier que sur ces six ou sept petites filles qui allaient toutes dans des écoles différentes, certaines avaient des institutrices douces et patientes. Mais au-delà du sourire, elles percevaient l’idée essentielle qu’on les commandait, ce qu’elles traduisaient par des vociférations.
« Peut-être ce métier d’enseignant a-t-il plus qu’un autre pour effet d’abîmer les gens qui l’exercent. On a dit que le pouvoir rendait fou et que le pouvoir absolu rendait absolument fou. Il est possible que l’autorité d’un maître sur un groupe d’enfants amoche à la longue son personnage et sa personnalité. » Je me réfugie derrière Michel Tournier[5] que je n’aime pas : je trouve plaisant de l’associer à ma voix, lui qui est l’une des coqueluches du corps enseignant.
Les profs sont des « logues » (je reprends le mot à Lucien Morin, du Québec), ceux qui parlent du haut de leur savoir. D’où le danger pour un élève d’en savoir plus que son maître.
Le maître a toujours raison. C’est lui toujours qui donne la bonne réponse : que la pédagogie soit directive ou non, le message qui passe, le seul enseignement est celui-là. Le maître « guide » vers la vérité avec plus ou moins de délicatesse mais il guide, qu’il soit Socrate ou le dernier des imbéciles. Il ne saurait y échapper. C’est le propre de l’enseignant. C’est pourquoi l’instruction obligatoire est criminelle : dans ce système de scolarité obligée, un professeur qui me dit qu’il « respecte » ses élèves me fait rire. Aurait-il le cran de soutenir qu’il ne corrige pas les erreurs ? Et corriger les erreurs de qui ne le demande pas, est-ce intelligent, utile, courtois ? Qui possède la vérité ? Ses propriétaires ne pourront être que violents. La vérité s’impose ; une vérité imposée par l’un ne peut-être que supposée par l’autre et perd ainsi ce qui la fonde. Tout détenteur de savoir représente potentiellement un danger extrêmement grave pour l’esprit. À plus forte raison lorsque le maître est maître absolu de la situation comme à l’école.
Mais son pouvoir s’est démultiplié encore ces deux dernières décennies. On attend de lui qu’il psychologise. Fréquemment, il dira d’un enfant turbulent qu’il est « caractériel », d’un autre qui ne suit pas qu’il est « débile léger », ou encore d’un individu silencieux et solitaire qu’il est psychotique. Le malheur ne vient pas de ce que l’enseignant puisse se tromper, mais de ce qu’il ose diagnostiquer.
Quelle libération, par exemple, pour les instituteurs de C.P. que la dyslexie ! Personnellement, j’ignore si elle existe vraiment dans le cerveau de l’enfant ; en tout cas, elle existe dans celui des enseignants. L’immense majorité des mioches a bien d’autres désirs à six ans que d’apprendre à lire (dans l’enquête que nous avons faite ensemble, tu as remarqué que parmi les enfants déscolarisés la plupart « réclamaient » l’apprentissage de la lecture vers huit ans, parfois plus tard). Ce qui permet à Baudelot et Establet de noter : « Le mécanisme est donc le suivant : l’école produit ses dyslexiques en dressant dès six ans, au cours préparatoire, un obstacle infranchissable pour la majorité ; elle s’en débarrasse ensuite en persuadant parents et enfants qu’ils ne doivent leurs échecs qu’à une infirmité congénitale dont elle n’est, quant à elle, ni la cause, ni la thérapeute. Elle les confirme ainsi dans le sentiment de leur infériorité et de leur impuissance : il n’y a plus rien à faire : l’enfant a entre six et sept ans[6]. »
On aurait pourtant tort de dire que ce n’est pas le rôle du maître que d’envoyer l’enfant dans des classes « spécialisées ». Son rôle est d’adapter au mieux l’enfant à la société. Cette noble fin justifie tous les moyens.
C’est ainsi qu’on ne saurait être moderne sans flirter avec la pédagogie institutionnelle. Pour pressurer l’enfant et lui faire rendre l’âme, c’est ce qu’on a fait de mieux jusqu’ici. Le professeur joue tout bonnement le rôle d’analyste de groupe. « Comme en psychanalyse, il importe que le professeur se taise pour laisser le groupe se cristalliser, se trouver lui-même[7]. » Et plus loin : « Nous pensons que si le rapport autoritaire — le rapport d’aliénation — doit être détruit, il ne peut l’être qu’“à la base”, en l’occurrence sous forme du rapport maître-élève […]. Nous avons été inspirés, dans notre mouvement, par la Psychosociologie, inspirée elle-même par la Psychanalyse. Le “groupe de diagnostic”, dans lequel J. Ardoino voit la nouvelle et authentique forme d’éducation, n’est-il pas en effet une contestation du rapport d’autorité comme le rapport psychanalytique lui-même[8] ? Le moniteur se refuse à commander, donner des consignes et des directives, enseigner, informer. Il se contente d’aider le groupe à fonctionner lui-même, à trouver son unité, à créer son réseau de communications […]. C’est ainsi que nous avons été amenés à concevoir l’“autogestion” de la classe ou du groupe scolaire en général[9]. »
« Ah ! qu’en termes galants ces choses-là sont mises ! »
Le même Lobrot parle de « non-directivité ». Je rêve ! ?
Nous serons manipulés de la même manière par des psys en politique.
Demain, nous autogérerons l’angoisse et la misère. Des « moniteurs » discrets nous aideront à « prendre conscience » de notre besoin de vivre en troupeau, nous permettront de créer nous-mêmes les conditions de ce qu’ILS appellent notre liberté.
Répugnant, n’est-ce pas ?
Et tu connais comme moi des « gens de bonne volonté », attachés à la pédagogie institutionnelle. Mais enfin n’ont-ils donc rien en toile de fond dans leur petite cervelle ? Rien qui leur permette de critiquer un système ?
Suffit-il d’opposer la modernité à l’archaïsme pour se donner l’illusion du progrès ? C’est l’idée d’éducation qui est une vieille lune. Un cours préparatoire en 1982 au Pré-Saint-Gervais, l’une des portes de Paris (ce n’est quand même pas le fin fond de la campagne profonde) : le maître du C.P., blouse grise, fait copier cent lignes de punition à ceux qui « ne suivent pas bien », les envoie « au piquet bras en l’air ». La directrice ne comprend pas que la mère de Noé ose se plaindre de M. X, « un maître dont la plupart des élèves savent lire à Noël ». D’accord, M. X fait un peu démodé. Mais ailleurs a-t-on supprimé les colles, les avertissements, les blâmes, les devoirs supplémentaires, les conseils de discipline, les exclusions momentanées, les définitives ? Et Gisèle Bienne[10], dans son très beau livre, note qu’à ces punitions il convient d’ajouter les insultes, les menaces constantes, le silence imposé, la confiscation d’effets personnels, les fouilles, les chantages à tous les niveaux.
On peut opérer plus en souplesse. Éléonore qui a neuf ans nous racontait : « Ma maîtresse, elle est vraiment incroyable ! Tous les jeudis, elle nous demande ce qu’on a fait le mercredi. Et, depuis le début de l’année, chaque fois que quelqu’un dit qu’il a regardé la télé, elle lève les yeux au ciel. Alors maintenant, on n’ose plus dire qu’on a regardé la télé mais si on n’invente pas très vite autre chose, les autres font “hou ! hou !” et rigolent en disant “il ou elle a regardé la télé !” Pourtant on le fait tous, regarder la télé, mais maintenant on a honte. » Les moins brutaux des maîtres ne sont pas les moins tyranniques. On se demande d’ailleurs pourquoi tant d’enseignants sont des vaches. Ils n’ont absolument pas besoin d’être si méchants pour se faire obéir. Dans l’expérience sur l’obéissance de Milgram, il apparaît bien clairement que les sujets ne se plient à l’ordre immonde de torturer que parce que celui qui commande possède l’autorité, et il ne possède cette autorité que parce qu’il est le professeur. À maintes reprises, les gens renâclent mais obéissent en disant comme un certain M. Gino (p.113) : « Vous êtes plus qualifié que moi. C’est vous le professeur. »
L’enseignant est tout-puissant, il a le savoir, le pouvoir et la complicité de tous.
Je ne vais pas t’ennuyer avec des références historiques, mais cela m’a beaucoup intéressée d’apprendre comment les écoles normales, au début du siècle, formaient instituteurs et institutrices comme des sortes de « prêtres laïcs » ; il s’agissait effectivement de constituer un pendant au clergé et, pour cela, viser à une sorte de sainteté. Le respect intégral des « vertus laïques » faisait des maîtres des personnes revêtues d’une dignité spéciale. (Ils reviennent de loin : quand on pense que les Romains confiaient le « vil » métier d’instituteur à des esclaves !) Il reste de cette consécration du XIXe siècle bien plus que ne croient ordinairement les intellectuels.
Face aux enseignants ou aux médecins, même sadiques, les parents se retrouvent plus que les non-parents dans une gangue d’impuissance, tant ils ont peur des représailles, effectivement possibles, sur l’enfant. Toubibs et professeurs sont maîtres d’un avenir sur lequel ils ont un pouvoir réel. Reste aux mères à faire du charme (les pères sont le plus souvent absents, il ne leur apparaît pas aussi « naturel » qu’aux femmes de se trouver en situation d’infériorité). Les opprimés en l’occurrence sont loin d’être révolutionnaires. L’hostilité plus ou moins larvée entre parents et enseignants revêt bien rarement celle d’une alliance entre parents et enfants humiliés contre les maîtres et seigneurs, mais d’une jalousie entre deux gangs de racketteurs sur le bas monde enfantin.
Deux cas de figure : ou bien on est de situation modeste et, c’est simple, face aux profs, on la boucle. Quitte à râler qu’à l’école on n’apprend plus aux enfants à vivre, que, de notre temps, on devait filer doux et qu’on savait dresser la jeunesse. Ou bien on a fait « les écoles » et, selon son grade, ou peut parler d’égal à égal ou en supérieur aux enseignants.
Tu sais bien ce que nous disait avant-hier Corinne : « C’est peut-être dégueulasse, mais je reconnais qu’en tant que prof j’ai un poids que n’ont pas les autres parents. Je joue sur la terreur qui règne dans l’institution et je peux me permettre de faire aux enseignants de ma fille des critiques ou des suggestions que jamais d’autres parents ne feraient. » Dégueulasse… ? Que veux-tu Corinne, c’est la jungle. Moi je ne me sentais pas capable de dépenser toute mon énergie pendant tant d’années dans cette guerre-là pour nous défendre Marie et moi, comme Suzanne fait pour Judith, comme ma mère l’a fait pour ses trois enfants.
Les rares expériences tentées pour obtenir une « coopération efficace » entre parents et enseignants ont pratiquement toujours été un formidable fiasco. Dans les écoles de pointe, « où l’on vit des rapports nouveaux », on s’offre le luxe de découvrir que les rapports ne peuvent pas changer tant que les gens restent enfermés dans le rôle social que la société les amène à jouer. En 1975, des enseignants de Vitruve (l’avant-garde !) écrivaient : « En ce qui nous concerne nous ne sommes plus dupes, après l’avoir pratiquée de nombreuses années, de la soi-disant ouverture de l’école aux parents qui, dans la stratégie ministérielle, ne vise qu’au renforcement du projet éducatif en place. Toutes les critiques qu’ils apportent en général ne concernent qu’une humanisation des rapports à l’intérieur de l’institution scolaire. Il faut avant tout que l’École continue à permettre la promotion sociale de leurs enfants. À Vitruve, certains parents ont utilisé l’ouverture de l’école pour veiller à ce que la reconnaissance des différences interculturelles ne fasse pas “baisser le niveau” et ne défavorise pas leurs gosses[11] ! »
Nous nous souviendrons longtemps de notre premier contact avec l’éphémère « collège autogéré ». Là, tout était vierge, tout était encore possible. Tu fus renversée comme moi par la première discussion à laquelle je me mêlai. J’avais pris ces notes texto ; je dis :
« Si vous tenez à avoir des enseignants, pourquoi justement les prendre parmi les professeurs ?
– T’achètes bien ta viande chez le boucher !
– Moi aussi j’ai appris des choses que je peux transmettre…
– C’est quand même plus simple que l’enseignement soit l’affaire des enseignants !
– ??? Chacun, professionnel ou non, ne peut-il proposer aux enfants et aux adultes ce qu’il aimerait faire partager ou approfondir ?
– Je crois que tu t’es trompée de lieu. Ici, ce n’est pas un lieu de vie… »
En effet, on sentait venir la mort et le projet était condamné d’avance. Il s’est déjà trouvé des médecins, au M.L.A.C.[12] par exemple, pour dire que la médecine pouvait être prise collectivement en charge par les gens ; mais qu’ils viennent me réconforter les enseignants qui œuvrent réellement pour que l’enseignement ne soit plus l’affaire des spécialistes ! Tant qu’à faire les clercs, quelques-uns auraient pu jouer les « prêtres-ouvriers » et aller enseigner les mathématiques ou l’histoire dans les usines…
Ah ! Y’a plus de vocation, ma petite demoiselle !
Dans notre société, tous les étudiants quels qu’ils soient et à tout âge devraient être payés ; tant que les écoles normales seront les rares établissements à offrir pareil appât, elles resteront un pôle d’attraction pour n’importe qui ayant besoin de gagner rapidement sa croûte. Sans compter qu’on peut être instituteur suppléant sans avoir fait l’école normale. Il suffit d’avoir le bac. Quand ils ont choisi leur métier, l’instituteur ou le professeur se sont, la plupart du temps, laissé séduire par les avantages de la fonction publique et les plus futés par la perspective de longues vacances.
Quant aux enseignants du deuxième degré, j’estime à 0,5 % la proportion de ceux que tente l’enseignement. Les autres, dans le meilleur des cas, étaient attirés par les études de philosophie, de physique ou de littérature et n’avaient guère de débouchés. Je dis « dans le meilleur des cas », car il est probable que même le choix des matières étudiées dépende relativement peu du plaisir qu’on en escompte. Bourdieu et Passeron font remarquer que la faculté des lettres peut servir de refuge pour les étudiants de la bourgeoisie socialement « obligés » à une scolarité supérieure qui s’orientent, par défaut d’une quelconque envie, vers ces études qui leur donneront « l’apparence d’une raison sociale ».
Évidemment, dans ces conditions, Neill, à Summerhill, qui exige de ses éducateurs qu’ils soient disponibles aux enfants vingt-quatre heures sur vingt-quatre, a fait figure de fou. On peut se demander si l’épuisement des adultes et le sacrifice de soi ne sont pas des contraintes supplémentaires pour les enfants.
Mais je comprends parfaitement que Neill puisse s’exaspérer du peu d’intérêt des enseignants pour leur métier et veuille rompre avec leur spleen mou. C’est comme l’auteur de Barbiana : lettre à une maîtresse d’école. Pas tendre, le bonhomme (il dit se servir parfois contre ses écoliers du martinet), mais maîtres et maîtresses se font fustiger dans son livre avec passion ; c’est bien plaisant à lire et je partage son point de vue au moins sur ceci : « Moi je vous paierais à forfait. Tant pour chaque gosse qui s’en tire dans toutes les matières. Ou mieux encore une amende pour chaque gosse qui n’arrive pas à s’en sortir dans une matière[13]. »
Il y a des profs sympas et intelligents. D’accord. Il y a aussi des patrons sympas et intelligents. C’est moins pénible de supporter sur son dos quelqu’un qui vous ménage (et qui ira plus loin) que quelqu’un qui vous crève. Mais où sont-ils les « profs sympas » qui remettent en question leur fonction ? Luttez, vous qui êtes « de gauche », contre la sélection et continuez à noter scrupuleusement vos élèves.
Et vous qui « faites » du Freinet, cessez de vous donner tant de peine pour recréer des « conditions normales d’existence » en faveur des mômes ; Freinet a été un homme audacieux, sincère et clairvoyant, mais il n’a pas vu à quel point sa démarche de vouloir « remettre l’enfant dans la vie » était artificielle. N’est-il pas quand-même plus simple de laisser l’enfant dans la vie ?
Plus on fait d’études, plus on se « spécialise », plus on rétrécit le champ critique. Les maîtres et maîtresses de maternelle reçoivent maintenant une « solide formation » (!). Ne sont-ils, ne sont-elles pas le fer de lance de l’éducation ? Ils et elles ont une influence terrible sur la « socialisation » des enfants. Est-ce que ça les inquiète ? Pas du tout. Désormais, imbus de leur science, ils apprennent en nouveaux riches à l’enfant comment se faire des amis, désamorcer une colère ou contrôler une discussion.
À aucun niveau, les maîtres ne contestent leur fonction, ce qui ne les empêche pas d’en être malheureux. Les professeurs râlent toujours, on sait bien. Je ne parle pas de ceux qui ne cessent de vitupérer le laxisme et le « niveau lamentable » des classes de baccalauréat. (M. Brunot dépose à la commission d’enquête parlementaire de 1899 sur l’enseignement secondaire : « Pour le grec, dit-il, il est une vérité qu’on ne saurait cacher ; les élèves sortent du collège sans en savoir un mot. Au baccalauréat, depuis que je fais passer cet examen pour mes péchés, je prends systématiquement un texte de Xénophon ou de Platon et, à la deuxième ligne, je m’arrête sur le premier verbe que je rencontre et je demande au candidat de conjuguer à l’indicatif présent : λυώ[14], etc. Or il n’y a pas deux élèves sur dix qui soient capables de répondre à cette question. Les formes leur sont inconnues, le vocabulaire également. Qu’on ne parle donc pas sérieusement d’une épreuve dont la cote est fictive. »)
Laissons ces plaisantins, leurs problèmes ne sont pas les nôtres. Mais d’autres, pauvres morfondus, feraient vraiment pitié… Certains, naguère, ont « cru » à leur métier, se sont donné du mal pour intéresser les mômes ; maintenant, ils s’estiment heureux quand ils n’ont d’ennuis ni avec les élèves, ni avec l’administration, ni avec les parents. Ils survivent et fument trop aux interclasses. Ils savent très bien qu’ils font perdre leur temps aux enfants et qu’eux-mêmes ont gâché leur vie.
Le 6 octobre 1983, la Direction des lycées demandait un débat dans les classes auquel faisait suite une consultation nationale des professeurs. J’ai lu ce rapport. Je te laisse savourer ces deux paragraphes (page 6) :
« Le souhait de relations plus humaines est unanime, comme le refus de la formule excessive : “relations de dominés à dominants”. L’amélioration des relations passe par le dégagement du temps nécessaire (1 h/semaine imputable sur les obligations de service), des effectifs réduits (25 élèves par classe), des équipes pédagogiques institutionnalisées (Comment ?), une information qui circule vraiment.
« Les débats traduisent cependant une interrogation, ou une difficulté : comment faire pour établir avec les adolescents une relation structurante qui n’exclut ni l’autorité ni la compréhension ? »
Que doit-on admirer le plus de la naïveté ou de l’esprit de synthèse des rédacteurs ? Ils veulent des relations « plus humaines » (un peu de chaleur de la part de leurs élèves…), passent par les revendications de type syndical et terminent sur un pitoyable « comment faire ? ». « Comment faire pour établir une relation structurante, etc. » C’est presque aussi drôle que Les Frustrés de Claire Bretécher.
Les profs, dans l’ensemble, sont malheureux, mais se font une raison. Une fois encore – c’est la dernière –, je rappelle l’une des principales conclusions de l’étude de Milgram sur la soumission à l’autorité : beaucoup blâmaient ouvertement, parfois avec violence, cette expérience qui leur demandait d’infliger un supplice à quelqu’un, certains en étaient malades. Mais ils poursuivaient ; leur colère leur permettait « nerveusement » de tenir et de continuer à obéir.
On me dit à tout bout de champ que l’École est perméable à différentes options politiques et qu’il n’est pas plus malin de parler d’elle que de parler de l’Église. Je dénonce les serviteurs d’une institution. Tu sais, ma chérie, que, parmi nos amis, des individus, enseignants, se livrent à une critique de l’Éducation nationale et de leur métier autrement plus péremptoire que je n’ai les moyens de le faire.
Des gens comme Daniel Hameline, Marie-Joëlle Dardelin, Jacques Piveteau ont mené cette critique très loin et ne risquent pas de se mystifier eux-mêmes. Par ailleurs, l’École émancipée[15] dès avant 1914 s’en prend très violemment à l’institution scolaire et affirme qu’il « faudra détruire l’école du système capitaliste ». Elle prône la lutte des classes et se considère comme partie intégrante de la classe ouvrière. L’école que veut l’École émancipée sera « partie prenante du socialisme des conseils ouvriers ». Tu n’étais pas née que j’étais sensible à ce discours. Ils ont évolué, moi aussi, et nous partageons quelques rares idées. Bien rares… Ils m’ont traitée souvent d’individualiste sans comprendre pourquoi je haussais les épaules en riant.
Je l’ai déjà répété, mais les gens s’identifient tellement à leur fonction que je redoute ici un grave malentendu. Je n’ai rien contre les enseignants : mes adversaires ne sont que les enseignants enfermés dans l’insupportable système scolaire et qui en acceptent les conditions tuantes aussi bien pour les gamins que pour eux. Mais c’est les vrais enseignants, les autres, que je défends contre les salariés de l’Éducation nationale et tous les privés assimilés. Il serait dément de ma part de t’éviter l’école si je ne savais pas, par expérience, qu’il y a de par le monde plein plein de gens qui ont des choses fantastiques à nous apprendre. Des êtres aiment passionnément faire aimer ce qu’ils aiment ; c’est rarissime dans l’enseignement officiel (à cause de l’obligation scolaire, des programmes, etc.) — je pense à mon petit frère qui fut toujours le seul à pouvoir me faire admettre la moindre démonstration scientifique, à des syndicalistes qui m’ont appris le minimum vital en histoire, à Alain L. qui faisait de si remarquables cours d’économie politique dans un groupe militant, à deux correcteurs d’imprimerie qui m’ont réexpliqué clairement des règles de grammaire complexes.
À l’école, même, j’ai eu un maître extraordinaire. Au début de son enseignement, Dominique avait onze ans, à peine, moi, treize. Elle m’a appris à lire, elle m’a appris que, derrière les murs, il y avait un monde. Elle m’a livré ce que je pouvais recevoir de son savoir avec une générosité et une patience qui me font fondre de tendresse aujourd’hui. Moi, je ne comprenais qu’une infime partie de ce qu’elle me disait. Infime vraiment… Mais je constate plus de vingt ans après que les pierres d’angle de ma vie ont été fondées sur les espaces de liberté qu’elle m’a ouverts. J’ai bénéficié trois ans de sa présence. J’ai grandi. J’ai vieilli. Souvent, il m’est arrivé de me battre contre des idées « reçues » avec plus de courage que je n’en ai naturellement, en secret témoignage de reconnaissance envers elle qui m’a appris à considérer le poids de la bêtise.
De toutes mes forces aimantes, Marie, ma très chère, je te souhaite de trouver des personnes capables de t’apprendre ce que tu désireras apprendre ; apprendre est l’une des plus grandes voluptés de la vie. On ne cesse de vouloir me convaincre qu’il y a des instits ou des profs qui adorent leur métier. Je le crois volontiers. Il y en a, surtout la première année d’enseignement. Mais, monsieur Oury, qu’est-ce qui empêcherait ceux-là d’enseigner dans une société où l’école ne serait plus obligatoire ? J’en connais en effet quelques-uns qui recherchent les lieux où ils sont sûrs de se trouver face à des gens qui les réclament. Olivier qui enseigne en prison dit de son travail qu’il s’apparente à celui d’un « écoutant ». Enseigner ne veut pas dire parler. Elles et ils m’ont bien écoutée celles et ceux qui m’ont fait part de leurs connaissances… Mais comment se taire, s’entendre quand on ne s’est pas choisi ?
L’intérêt des lieux anti-scolaires qui ont existé en France, qui existent encore en Allemagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, c’est que tous les adultes qui proposent un enseignement sont ensemble de leur plein gré et espèrent quelque chose les uns des autres. C’est le cas aussi aux lycées autogérés de Saint-Nazaire et de Paris où la cooptation a été de rigueur dès l’origine du projet ; lorsque ces lycées ont pu accueillir des élèves, ceux-ci ont choisi avec les professeurs les « nouveaux » (profs ou élèves).[16]
Aucune cellule de la société ne vaut la peine d’être défendue qui n’est pas l’association d’êtres libres qui y entrent volontairement et peuvent s’en retirer à tout moment sans avoir à pâtir de rien d’autre que de la séparation de ce groupe.
Je reviendrai dans un autre livre sur la belle histoire de la Ruche de Sébastien Faure. Je note en passant que les adultes qui enseignaient dans cette anti-école ne recevaient aucune rémunération salariée pour leur travail. Ils étaient nourris et logés. Pour leurs besoins personnels, ils puisaient dans une caisse commune sans avoir à en justifier. Tu imagines que si la Ruche a tenu une dizaine d’années, c’est que les « maîtres » se payaient de passion pour ce qu’ils faisaient.
Aujourd’hui encore dans le monde, quelques êtres qui contestent l’institution scolaire font enfin redécouvrir à tout un chacun qu’il aimerait enseigner ce qu’il sait. À Porto Rico, Angel Quintero a mené une expérience d’éducation populaire ; il a renoncé aux services des enseignants qualifiés avec lesquels il avait commencé à travailler, s’étant aperçu que les enfants et adolescents qui venaient d’apprendre quelque chose (lecture, montage d’un poste-radio, découvertes scientifiques, botanique, etc.) étaient ravis de transmettre leur savoir à leurs camarades et s’y prenaient bien mieux que les professeurs. Il a obtenu des résultats spectaculaires en confiant à des mômes le soin d’alphabétiser tel ou tel secteur.
Oui, j’en veux à tous ceux qui ne remettent en question que les programmes, ou le niveau, ou les « excès » de la discipline. J’en veux à tous ceux qui s’imaginent qu’ils peuvent, à des gamins obligés d’assister aux cours, enseigner quoi que ce soit. Je reconnais qu’ils ont des excuses. Car celles et ceux qui vont jusqu’au bout de leur critique se font jeter dehors comme des malpropres. Je pourrais faire un autre ouvrage avec tous les témoignages que j’ai reçus depuis dix ans sur les enseignants vidés de l’Éducation nationale. Mais ce qui m’a toujours frappée, dans ces histoires, c’est comment, le plus souvent, cette institution totalitaire crie « au fou ! » quand un enseignant dit ou fait enfin quelque chose de sensé. Dans son livre[17], Gisèle Bienne raconte comment elle parvient au miracle : des enfants heureux de découvrir des choses, elle-même commençant à avoir moins peur de ce métier terrible. À force d’intelligence, elle invente une nouvelle confiance entre elle et les écoliers. Beaucoup d’humilité, d’inquiétude, de tendresse transparaissent au long de ce récit. Dans les dernières pages, on apprend qu’un médecin de la Santé publique chargé des affaires sanitaires et sociales la prie de « prendre rendez-vous avec le psychiatre expert de l’hôpital psychiatrique du département pour un examen médical à des fins d’expertise dans le souci de compléter son dossier ». Quelle élégance ! Bénie soit la bêtise crasse de l’Éducation nationale : la littérature y aura gagné un très bon écrivain.
Le 7 juillet 1981, sous le titre « Le philosophe intenable », Le Monde racontait comment Jean-Pierre Blache, au moment où ses élèves de philo obtenaient au bac les plus fortes moyennes de l’établissement, se voyait l’objet d’une procédure disciplinaire. Blache doit avoir une cinquantaine d’années ; en Algérie déjà il avait eu droit au bataillon disciplinaire parce qu’il refusait de tenir une arme entre les mains. C’est un original. Fils de berger, il tient à ce qu’il juge raisonnable et n’accepte pas d’être mouton parmi les moutons. Mais… non, les braves gens n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux. Ce sont les arguments de Mme le Proviseur qui sont irrésistibles : elle désespère « de remettre M. Blache dans le droit chemin » et l’accuse de « semer la révolution dans un lycée dont l’atmosphère a totalement changé depuis son arrivée » ; voici les fautes dont elle l’accuse :
« M. Blache n’admet aucune règle, aucune discipline tant pour lui que pour les élèves.
« — il a fallu s’accrocher à ses basques plusieurs fois au début de l’année pour l’obliger à remplir les imprimés de sortie pédagogique avec des élèves. Dès qu’il faisait beau, il prenait la décision de partir ; un jour, le 8 octobre, il m’a téléphoné à 12 h 50 pour partir à 13 h !
« — de nombreux appels d’élèves n’ont pas été faits sur les cahiers d’appel.
« — le 18 septembre, il a fait déjeuner au lycée sa concubine, sans autorisation de Mme l’Intendante.
« — le mardi 16 septembre, il voulait emmener avec lui à une réunion syndicale les élèves de terminale F1 avec qui il avait cours.
« — a été vu par la conseillère d’éducation, le 9 décembre vers 13 h 20, au rez-de-chaussée, sous le préau, alors qu’il avait cours depuis 13 h au premier étage. Il a prétendu qu’il était revenu chercher en réunion syndicale son cartable qu’il avait oublié.
« — il critique toute sanction, qu’elle ait lieu à l’internat ou à l’externat, sans en connaître exactement les motifs. »
La suite est du même acabit. Et le recteur de l’académie de Nantes écrit au ministre… « La manière d’être désinvolte de cet agent, son indiscipline, sa tenue propre à soulever agitation et perturbation à l’intérieur de l’établissement ne sont pas dignes d’un éducateur. »
À côté de ceux-là qu’on a jetés dehors, combien d’autres, que je salue cordialement ici, qui ont démissionné !
À ceux qui ne sont pas encore partis mais sont malheureux, affolés par ce qu’on leur demande de faire ingurgiter aux élèves, dégoûtés, malades, je souhaite de gagner au loto, ou de se casser une jambe, ou d’hériter d’une mine d’uranium, ou d’écrire un livre à succès. Mais qu’ils se tirent avant qu’il ne soit trop tard. Le 13 avril 1984, après avoir reçu une réprimande, un élève tue son prof.
C’est quand même dommage pour les gosses de devoir en arriver là.
- ↑ Les écrits des enseignants, au début du siècle, sont, à cet égard, à fendre l’âme.
- ↑ Aphorismes, Premier cahier, 1764-1771, Georg Lichtenberg, Les Presses d’aujourd’hui, 1980.
- ↑ Pygmalion à l’école, L. Jacobson et R. Rosenthal, Casterman, 1972.
- ↑ Experimenter Effects in Behavioral Research, R. Rosenthal, New York, Appelton-Century Crofts, 1966.
- ↑ Dans Le Vent paraclet, Gallimard, 1977.
- ↑ L’École capitaliste en France, op. cit.
- ↑ La Pédagogie institutionnelle, M. Lobrot, Gauthiers-Villars, 1966.
- ↑ !!!!!!! (note de l’auteur).
- ↑ La Pédagogie institutionnelle, op. cit.
- ↑ Je ne veux plus aller à l’école, Gisèle Bienne, Éd. des femmes, 1980.
- ↑ Autrement, avril 1978.
- ↑ * Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception.
- ↑ Barbiana : lettre à une maîtresse d’école, Mercure de France, 1972.
- ↑ C’est le premier verbe qu’on apprend en grec.
- ↑ L’École émancipée (association loi 1901, créée en 1910) est aujourd’hui l’un des courants de la F.E.N.
- ↑ Ça a aujourd’hui cessé d’être le cas.
- ↑ Je ne veux plus aller à l’école, op. cit.